|
|
|
Jusqu'alors,
seul les établissements situés en France recevaient les bagnards il s'agissait
de Toulon, Brest, Rochefort, Lorient, Le Havre et Cherbourg. Enchaînés par deux
les forçats sont vêtus, afin d'être facilement reconnu en cas d'évasion, d'une
vareuse rouge, et d'un bonnet vert pour les condamnés aux travaux forcés à
perpétuité, et un bonnet rouge pour les condamnés à temps. Jusqu'en 1830 les
condamnés à perpétuité reçoivent un marquage TP au fer rouge sur l'épaule. La
peine des travaux forcés, commençait par ce qu'on appelle la grande fatigue,
toujours enchaînés, les condamnés sont employés au transport du bois, des
pierres, curage des bassins, aux travaux de terrassement, de construction, et
au sciage de long, pendant trois années au moins. Par la suite si le condamné
faisait preuve de bonne conduite il pouvait prétendre à l'exécution de travaux
moins pénibles: travaux bureaucratiques, comptables, cuisiniers, cantiniers,
jardiniers, peintres, tailleurs, balayeurs etc... Les emplois les plus recherchés sont les travaux dans les
hôpitaux. C'est la petite fatigue. |
|
Bien
que la réglementation ne prévoit pas de rémunération, certains, reçoivent une
gratification qui ne peut dépasser le sixième de celui d'un ouvrier libre. |
|
En
1822 à Toulon et 1829 dans les autres bagnes, les condamnés à temps, reçoivent
un pécule qui ne leur est distribué qu'au moment de leur libération. A cela
peut s'ajouter le fruit de la vente des objets confectionnés par eux pendant
les rares heures de repos.
|
|
Vols,
faux en écritures, escroqueries, désertions, ces délits envoient les condamnés
aux travaux forcés. Les crimes de sang aussi, pour les condamnés qui avaient la
chance d'échapper à la peine de mort.
|
|
Le
22 novembre 1850, le prince Louis Napoléon proclame : " 6000 condamnés
dans nos bagnes grèvent les budgets d'une charge énorme, se dépravant de plus
en plus, et menaçant incessamment la société. Il me semble possible de rendre
la peine des travaux forcés plus efficace, plus moralisatrice, moins
dispendieuse, et plus humaine en l'utilisant au progrès de la colonisation
française ". |
|
Prétextant
la ruine de la Guyane, le gouvernement français prend la décision, en 1851, de
transformer cette possession en un vaste pénitencier. Dans un rapport du 20
février 1852, Ducos, ministre de la Marine et des Colonies, indique les motifs
qui incitent le gouvernement à tenter une autre colonisation fondée sur le
bagne, qui débarrasserait la France d'une "vraie lèpre sociale qui
entretenait les traditions de l'école du crime dans les bas-fonds de la
population".
|
|
La
révolution avait ouvert la voie, et dés 1852 il fut décidé d'expatrier les
bagnards qui regorgent dans les établissements français.
|
|
La
frégate l'Allier, quitte Brest le 31 mars. A son bord, deux cent
quatre-vingt-dix-huit condamnés qui proviennent des bagnes de Brest et
Rochefort, et trois déportés politiques.
|
|
Les
départs pour le bagne de Guyane se faisaient à Brest, puis Toulon. Sous la
troisième république, les départs se font à partir de St Martin de Ré. Le
voyage dure environ trois semaines, plus si le bateau embarquait des
condamnés à Alger. |
|
Après
avoir séjourné à l'îlet
la Mère et à l'île Saint
Joseph, les déportés politiques sont dirigés vers l'île du Diable. Les
condamnés de droit commun, sont dispersés en plusieurs autres lieux, l'île Royale qui héberge
ceux considérés comme les plus dangereux, et à Cayenne sur des pontons au
large de la ville.
La
déportation de 1852 concerne autant les condamnés de droit commun que les
déportés politiques.
Logés
dans des locaux de fortune, devant l'affluence des arrivées, les condamnés
sont progressivement transférés des îles sur la terre ferme, à Remire Montjoly, localité
située à quelques kilomètres de Cayenne.
|
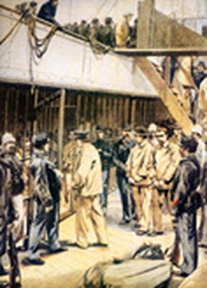
|
|
|
Au
mois de décembre, 1852, environs 2200 condamnés ont rejoint la Guyane. Les
installations de Remire devenues trop exiguës il fallut évacuer les bâtiments.
C'est à la montagne d'argent que les bagnards trouvent accueil. Ils sont
employés au travail dans les plantations de caféiers.
|
|
Les
maladies et le manque d'hygiène font d'énormes ravages parmi les condamnés.
|
|
L'année
suivante, 300 condamnés sont débarqués au pied de la Montagne d'Argent, 195 y
trouvent la mort peu après leur arrivée. |
|
La
faute est attribuée au Gouverneur Sarda Garriga qui, dit-on, n'avait pas pris
de bonnes dispositions d'accueil, mais aussi par l'épidémie de fièvre jaune qui
décime les condamnés et les surveillants. |
|
L'amiral
Fourrichon le remplace le 31 janvier 1854, et fonde à St Georges un nouvel
établissement où les condamnés participent à la création de la ville. Deux
tiers des effectifs y trouvent également la mort. Fourrichon au contraire de
son prédécesseur fait appliquer les châtiments corporels en usage dans les
bagnes de France. Le climat, les mauvais traitements ont raison de la santé de
ces hommes. Parmi ceux qui échappent à la mort, certains ont recours au suicide
pour échapper au terrible châtiment qui leur était infligé. Le camp de St
Georges est évacué en 1856.
|
|
En
six mois de juillet à novembre 1854 d'autres établissements sont crées, Ste Marie, St Augustin, et St Philippe sur la
rivière la Comté. |
|

L'île du Diable
|
Le
30 mars 1854, est votée la loi qui définit la transportation des condamnés
aux travaux forcés hors de France, et qui Institue en outre le doublage.
Cette loi entérinait enfin la pratique de la déportation mise en place depuis
1852.
En
1856 le pénitencier de Kourou
ouvre ses portes, Avec ses annexes, Guatémala, Léandre, Passoura, Pariacabo, et Trois
carbets.
|
|
|
Le
cinquième gouverneur de la Guyane en cinq ans, l'Amiral Baudin préconise la
création du pénitencier à St
Laurent, et le 21 février 1858 est inauguré ce nouvel établissement
|
|
Un
Décret de 1880 a érigé cette localité en commune pénitentiaire. Les citoyens
libres n'avaient pas droit de vote pour élire les administrateurs de la ville.
Celle ci était dirigée par une commission municipale composée de personnalités
appartenant à l'administration pénitentiaire et du commandant supérieur du
Maroni.
|
| |
© 2001-2005 Guy Marchal
|